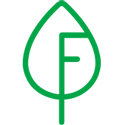Messages clés
-
Une revue de la littérature1 publiée dans le British Medical Journal (BMJ) a tenu compte de la grande hétérogénéité clinique de la population gériatrique pour proposer une prise en charge individualisée de la fibrillation auriculaire (FA).
-
Trois grands types de patients âgés peuvent être déterminés sur base de leurs comorbidités, degré de fragilité et espérance de vie. La prise en charge de la FA variera d’une catégorie de patients à l’autre. Un tableau récapitulatif est présenté à la fin de cet article.
-
Plutôt qu’un dépistage systématique de la fibrillation auriculaire, il est préférable d’agir sur les facteurs de risque de survenue de FA (obésité, sédentarité, consommation éthylique, hypertension artérielle).
-
Le développement des techniques d’ablation du foyer de FA par cathétérisme laisse davantage de place à une stratégie de type « rhythm control » pour certains profils de patients. C’est toutefois l’approche « rate control » qui continue d’être privilégiée dans les recommandations actuelles2,3,4,5.
-
L’anticoagulation n’est pas systématique, même si l’âge avancé (en particulier au-delà de 75 ans) représente un critère majeur en faveur de sa prescription, l’âge étant un facteur de risque pour le développement de thromboses. Lorsqu’elle est indiquée, les recommandations préconisent le recours à un anticoagulant oral direct (AOD) sauf si le patient bénéficie déjà d’une anticoagulation stable par un antagoniste de la vitamine K (AVK)2,3,6.
En effet, les AOD seraient aussi efficaces que les AVK dans la prévention des évènements thromboemboliques tout en exposant à un moindre risque hémorragique. En outre, l’apixaban semble être la molécule avec le profil de sécurité le plus sûr parmi les AOD. Néanmoins, chez les patients bien stabilisés sous AVK, le remplacement de l’AVK par un AOD expose à un risque hémorragique accru. -
L’acide acétylsalicylique n’a pas de place comme alternative à l’anticoagulation car il augmente le risque hémorragique sans apporter de protection satisfaisante contre la survenue des évènements thromboemboliques liés à la FA.
-
Commentaires du CBIP :
– Il est important de distinguer les différents traitements regroupés sous le terme de « rhythm control ». La prudence doit toujours rester de mise avec les médicaments antiarythmiques, en raison de leur marge thérapeutique-toxique étroite, de leurs nombreuses interactions et du risque d’effets indésirables graves.
– En l’absence de données comparatives issues d’essais contrôlés randomisés, il reste difficile d’adopter un positionnement clair quant au choix préférentiel de l’une ou l’autre molécule pour l’anticoagulation d’une FA.
En quoi cet article est-il important ?
La fibrillation auriculaire est une pathologie survenant majoritairement chez les patients âgés : 80% des patients atteints de FA ont ≥ 65 ans et on estime qu’environ 10% des patients de 80 ans ont une fibrillation auriculaire4.
La plupart des études s’intéressant à la prise en charge de la FA incluent surtout des patients âgés non fragiles qui n’ont que peu de comorbidités.
Pourtant, les patients âgés atteints de FA rencontrés dans la pratique ont un profil fort différent. Ceux-ci sont souvent multimorbides, polymédiqués, souffrent parfois de syndrome(s) gériatrique(s) ou peuvent avoir une espérance de vie limitée. Ces patients sont donc en réalité sous-représentés dans les études à l’origine des recommandations de bonne pratique.
En outre, suivant leurs comorbidités et leur espérance de vie, les patients âgés peuvent avoir des priorités fort différentes quant aux objectifs de santé à atteindre.
Cette nouvelle revue de la littérature, publiée dans le BMJ1, propose une prise en charge individualisée de la FA pour les patients âgés, en tenant compte à la fois de leur degré de fragilité mais aussi de leurs souhaits de fin de vie.
Protocole
La recherche de la littérature utilisée pour cet article s’est concentrée sur les essais cliniques randomisés (RCT) publiés de 2010 à mai 2023 qui s’intéressaient spécifiquement à la fibrillation auriculaire chez les personnes âgées.
Résultats
Un patient âgé n’en est pas un autre
Face à la très grande hétérogénéité de la population gériatrique, les auteurs proposent de distinguer 3 catégories de patients. Celles-ci varient selon l’espérance de vie et la présence/sévérité des comorbidités des patients âgés.
Cette classification a l’avantage de proposer une prise en charge spécifique de la FA pour chaque catégorie de patients.
Ces différents profils peuvent être résumés de la manière suivante :
-
Le patient en forme et autonome
-
Patient présentant peu de comorbidités et dont l’espérance de vie est supérieure à 10 ans.
-
La prise en charge sera généralement identique à celle des patients plus jeunes.
Le patient multimorbide et fragile
-
Patient présentant des comorbidités plus sévères, dont des syndromes gériatriques (par ex. chutes à répétition). Son espérance de vie est d’une à dix années.
-
La prise en charge sera individualisée à chaque patient, étant donné la multitude de variantes possibles.
-
-
Le patient en fin de vie
-
Patient souffrant d’une maladie avancée/terminale et dont l’espérance de vie est inférieure à 1 an.
-
Seuls les traitements apportant une réelle plus-value au confort du patient seront envisagés et/ou conservés.
En pratique, il peut être difficile de déterminer le niveau de fragilité ou l’espérance de vie d’un patient âgé.
Ceux-ci peuvent néanmoins être estimés à l’aide d’outils en ligne, bien que la méthode la plus adaptée à cette fin reste l’évaluation gériatrique multidisciplinaire.
Par exemple, les auteurs de l’article proposent d’utiliser l’échelle Clinical Frailty Scale pour quantifier la fragilité du patient âgé ou encore, l’outil ePrognosis pour estimer son espérance de vie.
-
Les auteurs de l’article rappellent également l’importance de tenir compte des volontés du patient. En effet, un traitement qui semble pourtant adapté aux caractéristiques du patient âgé n’est pas forcément celui qui lui conviendra le mieux en pratique (par ex. refus d’une procédure en raison de ses effets indésirables potentiels).
Plutôt qu’un dépistage systématique, agir sur les facteurs de risque
Le dépistage de la FA ne fait aucun doute après un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un accident ischémique transitoire (AIT).
Cependant, le bénéfice d’un dépistage chez le patient tout-venant est moins clair.
En effet, il n’existe pas de preuve solide que la détection accrue de FA chez les sujets âgés se traduise par un bénéfice clinique, tel qu’une réduction des AVC.
Néanmoins, certaines mesures hygiéno-diététiques peuvent être mises en place pour diminuer le risque de survenue de FA :
-
perdre du poids en cas d’obésité* ;
-
réaliser une activité physique régulière d’intensité légère à modérée ;
-
éviter la consommation d’alcool ;
-
veiller au bon contrôle tensionnel.
* Chez les patients âgés, c’est plutôt un contrôle du poids qui sera généralement recherché afin d’éviter toute perte de masse musculaire.
Cette revue de la littérature propose les recommandations suivantes pour les différents profils de patients âgés :
-
Le patient en forme et autonome
-
La décision de réaliser un dépistage doit se faire en concertation avec le patient.
-
Il est recommandé d’agir sur les facteurs de risque.
Le patient multimorbide et fragile
-
Il est difficile d’établir une recommandation claire pour cette catégorie de patients en raison de la grande variabilité interindividuelle qui la caractérise. Le dépistage peut s’avérer potentiellement non bénéfique pour certains patients.
-
La décision d’agir ou non sur les facteurs de risque doit se faire en concertation avec le patient.
Le patient en fin de vie
-
Le dépistage n’a pas de place dans la stratégie palliative.
-
Contrôler le rythme ? Oui, mais…
Deux stratégies thérapeutiques coexistent dans la prise en charge de la fibrillation auriculaire : le contrôle de la fréquence (« rate control ») et du rythme (« rhythm control »).
- Le contrôle de la fréquence cardiaque (« rate control ») a pour but de ralentir le rythme cardiaque, le plus souvent à l’aide d’un bêta-bloquant ou d’un antagoniste du calcium. Dans la majorité des cas, cette stratégie suffit à soulager les symptômes du patient.
- Le contrôle du rythme (« rhythm control ») vise un retour et un maintien au long cours du rythme sinusal. Diverses techniques peuvent être utilisées à cette fin : la cardioversion par choc électrique externe, la cardioversion médicamenteuse (utilisation d’un antiarythmique per os dans le cas d’une stratégie « pill in the pocket » ou intraveineux), l’utilisation d’antiarythmiques au long cours ou encore l’ablation du foyer de FA par cathétérisme. A noter qu’en cas de succès de l’ablation, une utilisation d’antiarythmiques au long cours n’est pas nécessaire.
Les guidelines actuelles2,3,4,5 recommandent de privilégier l’approche « rate control ».
Toutefois, le développement et l’amélioration des techniques d’ablation du foyer de FA par cathétérisme au cours de ces dernières années sont à l’origine d’un regain d’intérêt envers la stratégie « rhythm control ». L’European Society of Cardiology (ESC)3 recommande de considérer le contrôle du rythme chez les patients atteints de FA et propose l’ablation par cathétérisme comme traitement de première intention dans plusieurs indications.
C’est dans ce contexte que les auteurs de cet article ont tendance à préconiser l’approche « rhythm control » chez les patients âgés en forme et autonomes.
Chez le patient âgé fragile multimorbide, cette stratégie reste envisageable (par ex. en cas de FA altérant la qualité de vie).
Dans les situations de fin de vie, l’approche « rhythm control » n’a de sens que si elle permet un gain de confort. L’ablation par cathétérisme semble cependant peu adaptée à ce profil de patients.
Et chez le patient insuffisant cardiaque ?
Bien souvent, FA et insuffisance cardiaque sont étroitement liées : l’insuffisance cardiaque augmente le risque de survenue de FA et la FA aggrave l’insuffisance cardiaque.
En cas d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite (HFrEF), les auteurs de l’article recommandent le recours précoce à une stratégie « rhythm control », le premier choix revenant à l’ablation par cathétérisme. (NB CBIP: la plupart des antiarythmiques sont de toute façon contre-indiqués en cas d’insuffisance cardiaque).
Les insuffisances cardiaques à fraction d’éjection préservée (HFpEF) n’ont pas fait l’objet d’une discussion dans cette revue de la littérature.
Anticoaguler : Oui/non ? Comment ?
Pas d’anticoagulation systématique
L’anticoagulation des patients âgés de ≥ 75 ans fait partie des guides de pratique clinique actuels, les scores CHA2DS2-VASc et CHA2DS2-VA étant utilisés par la plupart des organisations.
- Les scores CHA2DS2-VASc et CHA2DS2-VA sont les scores cliniques les plus répandus dans les différentes recommandations de bonne pratique relatives à la fibrillation auriculaire.
Ils évaluent le risque d’AVC et autres évènements thromboemboliques chez les patients atteints de FA non valvulaire et sont utilisés comme aide à la décision d’une éventuelle anticoagulation. - Le score CHA2DS2-VASc attribue une valeur de 1 point pour une insuffisance cardiaque chronique, une hypertension, un âge entre 65 et 74 ans, un diabète, une pathologie vasculaire ou un sexe féminin. Il attribue une valeur de 2 points pour un antécédent d’AVC/AIT ou un âge ≥ 75 ans.
- Le score CHA2DS2-VA utilise les mêmes critères, à l’exception du critère du genre.
- L’anticoagulation étant recommandée lorsque le score CHA2DS2-VASc ≥ 2 chez les hommes et ≥ 3 chez les femmes2 ou lorsque le score CHA2DS2-VA est ≥ 23, un âge ≥ 75 ans suffit pour atteindre de tels scores et recommander une anticoagulation.
Cependant, la pertinence d’une thromboprophylaxie chez le patient âgé peut être remise en question pour plusieurs raisons :
-
le risque hémorragique sous anticoagulants augmente avec l’âge ;
-
les patients de > 80 ans sont sous-représentés dans les études évaluant les anticoagulants dans la prévention des AVC ;
-
les patients avec un âge avancé sont à haut risque d’autres évènements morbides qu’un AVC.
-
Dès lors, les auteurs de cette revue de la littérature proposent les recommandations suivantes :
-
Pour les 3 profils de patients, il y a lieu d’agir sur les facteurs de risque hémorragiques réversibles :
-
assurer un bon contrôle de la tension artérielle ;
-
éviter l’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ;
-
considérer la prescription d’inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) chez les patients traités par au moins deux agents antithrombotiques ;
-
si possible, déprescrire les agents antiplaquettaires (par ex. privilégier une anticoagulation en monothérapie plutôt qu’une combinaison anticoagulation/thérapie antiplaquettaire au long cours).
-
-
Chez le patient âgé en forme et autonome : l’anticoagulation est recommandée.
-
Chez le patient multimorbide et fragile : la décision d’anticoaguler ou non doit se faire au cas par cas, en concertation avec le patient.
-
Chez le patient en fin de vie : l’arrêt de l’anticoagulation doit être envisagé en raison d’une balance bénéfices-risques vraisemblablement défavorable.
A noter qu’il est toujours utile d’évaluer le risque hémorragique (par ex. score clinique HAS-BLED) parallèlement au risque thrombo-embolique du patient atteint de FA. Le risque hémorragique pouvant fluctuer au fil du temps, l’utilisation d’un tel score clinique est surtout utile pour identifier/gérer d’éventuels facteurs de risque hémorragiques réversibles et évaluer si un suivi clinique plus soutenu est nécessaire4. Par conséquent, les scores cliniques évaluant le risque hémorragique ne doivent pas, à eux seuls, justifier une contre-indication formelle à l’anticoagulation4.
Privilégier l’apixaban, sauf chez le patient bien contrôlé sous AVK ?
Selon les auteurs de l’article, lorsqu’une anticoagulation est indiquée, les anticoagulants oraux directs (AOD) devraient être préférés aux antagonistes de la vitamine K (AVK).
Les auteurs justifient cette prise de position en mentionnant un profil d’efficacité similaire entre les deux classes médicamenteuses tout en rappelant un risque plus important d’interactions et de saignements avec les AVK.
En outre, l’absence d’un suivi biologique pour les AOD est moins contraignant pour le patient.
En se basant sur les données observationnelles actuellement disponibles, l’article renseigne l’apixaban comme premier choix en raison d’un moindre risque hémorragique par rapport aux autres AOD.
Si le patient bénéficie déjà d’une anticoagulation stabilisée sous AVK, il est recommandé de ne pas changer l’anticoagulation pour un AOD en raison d’une majoration du risque hémorragique sans plus-value sur les complications thrombo-emboliques.
(NB CBIP: les AVK restent un premier choix en cas de sténose mitrale ou de prothèse valvulaire).
Enfin, l’acide acétylsalicylique n’a pas de place comme alternative à l’anticoagulation car il augmente le risque hémorragique sans apporter de protection satisfaisante contre la survenue des AVC.
Et si le patient est insuffisant rénal ?
L’insuffisance rénale chronique est associée à un plus grand risque de survenue de FA et d’AVC mais aussi à un plus grand risque hémorragique.
Cette revue de la littérature donne les informations suivantes :
-
En cas d’insuffisance rénale légère à modérée, les auteurs recommandent une anticoagulation par AOD ou AVK.
(NB CBIP: à l’exception de l’apixaban, une adaptation de la posologie des autres AOD est déjà nécessaire en cas d’insuffisance rénale modérée (DFG entre 30 et 59 mL/min/1,73m2)). -
En cas d’insuffisance rénale sévère (DFG < 30 mL/min/1,73m2), la recommandation d’anticoaguler (par un AOD ou un AVK) devient faible.
(NB CBIP: si l’usage de certains AOD reste possible chez ces patients, il faut préciser que le dabigatran devient contre-indiqué pour un tel débit de filtration glomérulaire et que la posologie des autres AOD (y compris l’apixaban) doit être adaptée. La posologie de l’apixaban doit également être adaptée si le patient présente au moins 2 des 3 caractéristiques suivantes : ≥ 80 ans, ≤ 60 kg, créatinine ≥ 1,5 mg/dL). -
En cas d’insuffisance rénale terminale, aucune étude n’a démontré de bénéfice clair en faveur de l’anticoagulation. Des études sur le sujet sont en cours et les premiers résultats suggèrent que les AOD pourraient être une alternative aux AVK chez ces patients, ceci reste à confirmer.
(NB CBIP: à noter que le dabigatran est de toute façon contre-indiqué en cas de DFG < 30 mL/min/1,73m2 et que les RCP (résumés des caractéristiques du produit) des autres AOD déconseillent leur utilisation pour un tel niveau de DFG.)
Commentaire du CBIP
Cette revue de la littérature a eu le mérite de s’intéresser à la problématique de la fibrillation auriculaire chez les personnes âgées fragiles. Cette population était jusqu’ici trop souvent sous-représentée dans les études servant de bases aux guides de pratique clinique.
Lorsqu’on mentionne la stratégie « rhythm control », il est important de distinguer l’ablation du foyer de FA par cathétérisme du traitement médicamenteux antiarythmique.
En effet, le regain d’intérêt pour le contrôle du rythme est majoritairement dû à l’étude EAST-AFNET47.
Les traitements utilisés pour le contrôle du rythme étaient majoritairement l’utilisation d’antiarythmiques (86,8% des participants au début de l’étude puis 45,7% à 2 ans) et dans une moindre mesure l’ablation du foyer de FA par cathétérisme (8% des participants au début de l’étude puis 19,4% à 2 ans).
Cette étude avait montré que, comparativement à une stratégie « rate control », un contrôle du rythme dans l’année suivant le diagnostic de FA était associé à une réduction du risque de mort cardiovasculaire, d’AVC ou d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou syndrome coronarien aigu (HR 0,79 avec IC95 0,66 à 0,94).
Le groupe « rhythm control » reprenant deux types d’interventions bien distinctes (ablation par cathétérisme vs utilisation d’antiarythmiques), il est difficile de tirer des conclusions claires quant au bénéfice de cette stratégie thérapeutique et il est possible que les résultats positifs liés au contrôle du rythme soient influencés par le recours à la procédure d’ablation.
En effet, dans plusieurs études8, l’ablation s’est révélée plus efficace que le traitement médicamenteux antiarythmique en terme de contrôle du rythme.
En outre, une méta-analyse récente9 a également montré, qu’en dehors de la phase aiguë post-interventionnelle, l’ablation était supérieure au traitement médicamenteux sur des critères cliniques forts (AVC ischémique, mortalité totale, hospitalisation pour insuffisance cardiaque).
Il y a donc lieu d’être vigilant lorsque les auteurs de cette revue de la littérature recommandent le recours à une stratégie « rhythm control ». La prudence doit toujours rester de mise avec les traitements antiarythmiques, en raison de leur marge thérapeutique-toxique étroite, de leurs nombreuses interactions et du risque d’effets indésirables graves.
Enfin, il convient de rappeler que malgré l’intérêt croissant suscité par les stratégies de contrôle du rythme, c’est l’approche « rate control » qui continue d’être privilégiée dans les recommandations actuelles.2,3,4,5
Le CBIP regrette l’absence d’essai clinique randomisé comparant les anticoagulants dans la prévention des évènements thromboemboliques liés à la FA.
Dans cette revue de la littérature, la préférence pour un AOD (et plus particulièrement, l’apixaban) repose sur des études observationnelles.
Pour ces raisons, le CBIP estime qu’il reste difficile d’adopter un positionnement clair quant au choix préférentiel de l’une ou l’autre molécule pour l’anticoagulation d’une FA.
Tableau-résumé : Prise en charge de la FA chez le patient âgé proposée par l’article BMJ
|
En forme/Autonome |
Multimorbide/Fragile |
Fin de vie |
|
|
Comorbidités Espérance de vie |
+/- > 10 ans |
++ 1-10 ans |
+++ < 1 an |
|
Dépistage |
A discuter |
Trop peu de données |
Non recommandé |
|
Agir sur facteurs de risque |
Recommandé |
A discuter |
Seulement si ↗ confort |
|
Rhythm control ? |
Préconisé |
Envisageable |
Seulement si ↗ confort |
|
|
NB CBIP: Rate control reste un premier choix dans les guidelines2,3,4,5 |
||
|
Anticoagulation |
Discuter de la balance bénéfices/risques – Agir sur les facteurs de risque |
||
|
|
Recommandée |
A discuter |
Envisager arrêt |
|
|
Données observationnelles en faveur des AOD (apixaban) NB CBIP: Absence de RCT comparant les anticoagulants dans la FA |
||
Sources
1 Parks AL, Frankel DS, Kim DH, et al. Management of atrial fibrillation in older adults. BMJ. 2024;386:e076246. Published 2024 Sep 17. doi:10.1136/bmj-2023-076246
2 NHG-Richtlijnen Atriumfibrilleren.
3 Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2024;45(36):3314-3414. doi:10.1093/eurheartj/ehae176
4 BMJ Best Practice. Established atrial fibrillation. Consulté le 08/05/2025.
5 National Institute for Health and Care Excellence. (2021). Atrial fibrillation: diagnosis and management. [NICE guideline NG196].
6 By the 2023 American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023;71(7):2052-2081. doi:10.1111/jgs.18372
7 Kirchhof P, Camm AJ, Goette A, et al. Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2020;383(14):1305-1316. doi:10.1056/NEJMoa2019422
8 Schwennesen HT, Andrade JG, Wood KA, Piccini JP. Ablation to Reduce Atrial Fibrillation Burden and Improve Outcomes: JACC Review Topic of the Week. J Am Coll Cardiol. 2023;82(10):1039-1050. doi:10.1016/j.jacc.2023.06.029
9 Montané B, Zhang S, Wolfe JD, et al. Catheter and Surgical Ablation for Atrial Fibrillation : A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. Published online July 1, 2025. doi:10.7326/ANNALS-25-00253